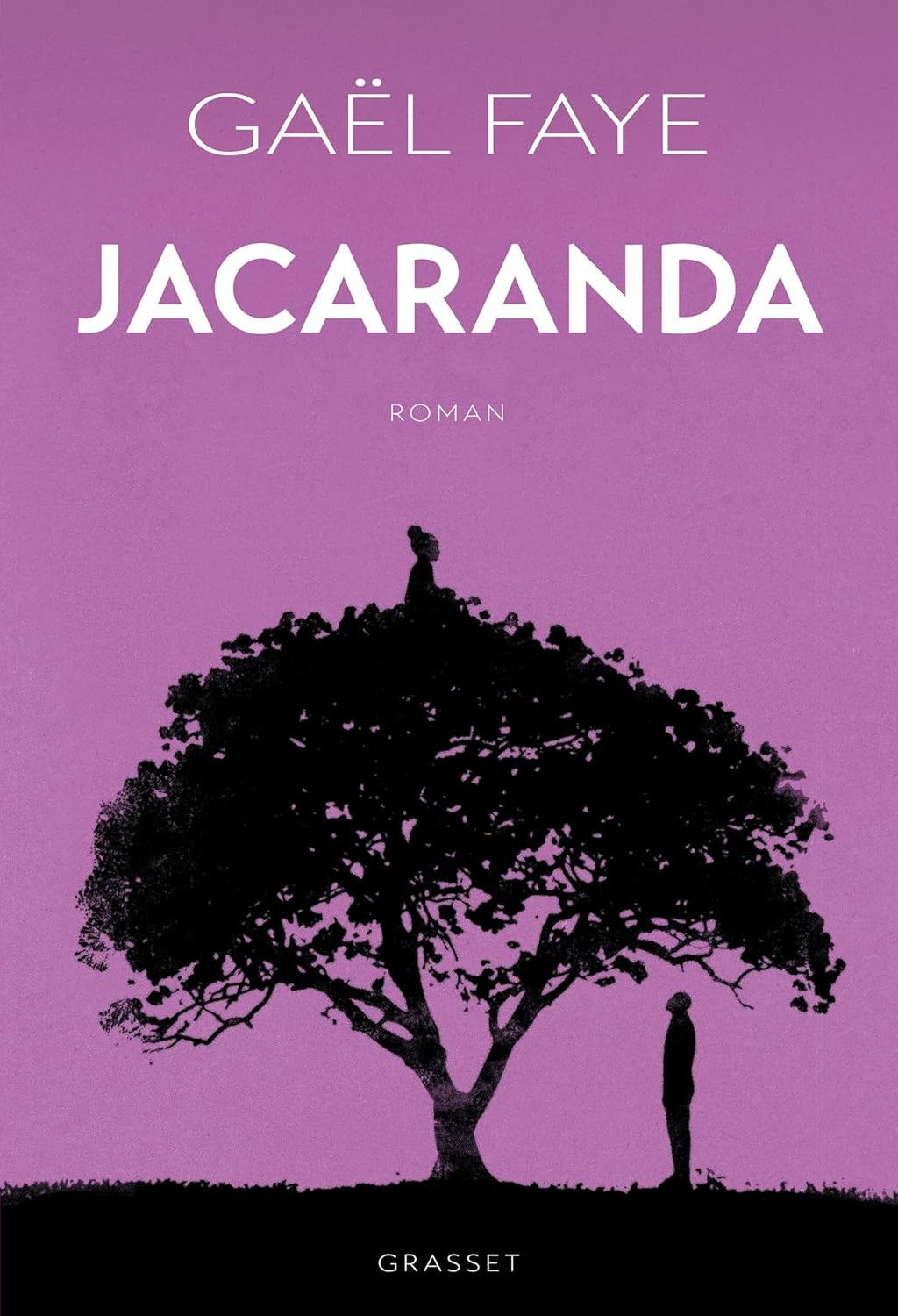
Avec Jacaranda, son deuxième roman publié chez Grasset en 2024, Gaël Faye revient à son obsession centrale : comment transmettre un passé marqué par l’horreur, comment faire parler les silences ? Il m’a fait penser à Murambi, le livre des ossements de Boubacar Boris Diop, notamment avec cette subtilité, pas évidente, à donner la parole à la victime autant qu’au bourreau. Non pas pour faire le procès. Mais pour dire la terreur, nommer l’innommable pour espérer parvenir à une thérapie progressive.
Dans Jacaranda, le regard change : le narrateur, Milan, est un jeune métis franco-rwandais né en France qui, jusqu’à ses seize ans, ignore tout de ses origines. C’est en France, loin du Rwanda, qu’il grandit dans une ignorance imposée par une mère, Venancia, mutique et brisée. Ses tentatives d’en apprendre davantage sur ses origines font à chaque fois face à des réponses laconiques et à la colère de sa génitrice. Il regarde à la télé le déroulement des atrocités liées au génocide, mais sa mère n’en fait jamais aucun commentaire. Quand, à 16 ans, il accompagne sa mère au Rwanda, il croit pouvoir en apprendre davantage sur ce pays. Mais les plaies ouvertes saignent encore trop fortement pour que les langues se délient.
En plus, la barrière linguistique ne l’y aide pas beaucoup : il ne parle pas un seul mot de kinyarwanda. Ce premier séjour sera écourté par le décès de sa grand-mère paternelle en France. Mais il reviendra.
Son retour au pays, vise à enquêter sur les procès gacaca. Cependant, il comprend vite qu’il est lui-même un fragment de cette histoire qu’il tente de comprendre.
Faye tisse alors une fresque polyphonique où l’intime se mêle au collectif. Le roman raconte les cicatrices, les chocs post-traumatiques, les alliances morales impossibles. Claude, l’oncle de Milan, est plaignant dans un procès. Sa proximité affective empêche Milan d’être neutre _ preuve que, dans le Rwanda post-génocide, tout discours est impliqué, toute parole politique.
Le silence est partout, la suspicion aussi. À Kigali, on marche pratiquement sur des œufs. Il faut éviter de retourner le couteau dans la plaie en posant des questions indiscrètes. « Chaque question, même la plus banale, paraissait susciter une certaine méfiance. Je me surprenais régulièrement à ravaler une parole de peur de blesser, choquer, commettre une gaffe ou paraître indiscret. » Il l’a d’ailleurs appris à ses dépens en traitant Sartre de pilleur, pour rire, ce qui l’a plongé dans une colère telle qu’il a fallu l’étrangler.
Heureusement, la parole trouve des failles. D’abord avec Alfred, un soldat flegmatique, lui aussi victime, mais qui a peut-être mieux que beaucoup su faire preuve de résilience. « Alfred ne donnait pas ce sentiment, il était léger et ouvert, il ne correspondait en rien à la représentation que j’avais d’un militaire rwandais. »
Mais la vraie faille, c’est Stella, la fille d’Eusébie, qui la trouve. Elle ouvre la voie en enregistrant les souvenirs de Rosalie, son arrière-grand-mère, dont la mort à 115 ans la brise carrément. À travers elle, c’est toute une mémoire refoulée qui resurgit : la royauté précoloniale, les trahisons ecclésiastiques, l’introduction des cartes ethniques, la complicité des puissances occidentales, les massacres de 1994 — quand Français et Belges préféraient sauver les chiens d’ambassade plutôt que les enfants tutsis.
Jacaranda prend à bras-le-corps la cruauté, mais aussi la complexité. Le personnage de Sartre, fils de génocidaire devenu protecteur d’orphelins, incarne ces figures troubles, ni tout à fait coupables, ni tout à fait rachetés. Comme Paul Ricœur l’analyse dans La mémoire, l’histoire, l’oubli, il ne s’agit pas de « tout se rappeler » mais de discerner ce qu’il faut transmettre pour construire une mémoire juste _sans simplification, ni vengeance.
Faye évoque aussi une société en reconstruction, où la ville de Kigali devient un décor flambant neuf qui recouvre les ruines intérieures. Le béton ne soigne pourtant pas les plaies, et Stacie, l’amie de Stella, le dit bien : les injustices perdurent. À ce propos, une certaine élite joue de sa position, de son pouvoir, pour obtenir toutes les faveurs. Cela est visible dans une scène, celle durant laquelle on empêche à Stella de lire le portrait qu’elle a réalisé pour rendre hommage à son arrière-grand-mère, précédemment sélectionné pour être lu lors de la fête de l’école, mais curieusement remplacé. Pour la raison, lisons Milan :
« L’adjoint de direction nous accueillit froidement, nous répétant la même histoire de confusion dans la sélection. Eusébie demanda à parler au directeur, qui affirma ne pas être au courant de ce cafouillage. Tout le monde se renvoyait la balle. Et puis tout s’est éclairé : l’enfant sélectionné au dernier moment avait écrit un texte élogieux sur son père, présent dans la salle et qui était un des ministres les plus en vue du gouvernement ; il y avait eu des pressions en coulisses et l’administration de l’école s’était couchée. Il n’y avait rien à faire. Stella refusa de rester à la fête et, durant tout le trajet et les heures qui suivirent, elle pleura toutes les larmes de son cœur meurtri par l’injustice, avant de s’enfermer dans sa chambre toute la journée. » ( la scène m’a rappelé plusieurs scènes dans mon propre pays. Dommage!)
Au milieu de ce chaos, le livre laisse une place au pardon, à la résilience. L’un des exemples est Stella elle-même, qui, après sa grosse désillusion, traduit son histoire en kinyarwanda et la lit à une fête populaire organisée par Sartre à l’attention des anciens pensionnaires du « Palais », du nom de sa concession. Le personnage du Chat, bourreau de la famille de Claude, revient, et dans une scène poignante, c’est le dialogue _ improbable mais nécessaire _ qui finit par se frayer un chemin. On voit ses enfants donner un coup de main à Claude alors que c’est Le Chat qui exécuta ses parents et lui fendit la tête à la machette.
Et puis il y a l’arbre, le jacaranda, au cœur du titre. Il est abattu à un moment clé du récit, lorsque Eusébie _ figure de courage et prototype de la résilience _ choisit de couper symboliquement le lien avec un passé trop lourd à porter. Sous ses branches sont enterrés ses premiers enfants, brûlés vifs par les miliciens. Sa disparition, loin d’être anodine, précipite la chute de Stella, qui y perd son ancrage. L’arbre, caveau, refuge et mémoire vivante, résume à lui seul l’ambivalence du souvenir : à la fois douleur persistante et nécessité vitale.
La dernière phrase du roman, « Je ne suis plus seul », prononcée par Milan sur le lac Kivu, dit bien la vocation de Jacaranda : réparer, doucement, ce que le silence et la terreur ont brisé. Avec ce texte bouleversant, Gaël Faye donne à la littérature un rôle thérapeutique et politique. Il rappelle que si l’histoire est souvent écrite par les vainqueurs, la fiction, elle, peut encore sauver la vérité des cendres.
Preston Kambou
Nous contacter au +237695521762




